La postcolonisation de la recherche française est-elle positive ? par Florian Louis
A propos de Jean-François Bayart, Les études postcoloniales, un carnaval académique, Editions Karthala, Paris, janvier 2010.
Les sciences humaines et sociales françaises doivent depuis quelques années faire face à une offensive en règle de chercheurs et de militants –le plus souvent de chercheurs-militants, les accusant d’une coupable surdité à l’égard des voix venues d’outre-Atlantique révéler le persistant impensé colonial niché au cœur de l’epistémé occidentale dont elles seraient les porteuses plus ou moins consentantes. Empêtrée dans son proverbial « provincialisme », l’université française n’aurait, selon lesdits accusateurs, pas offert aux études postcoloniales anglo-saxonnes l’accueil enthousiaste que leur nouveauté et leur sagacité auraient légitimement dû leur assurer.
Face à cette accusation sans cesse réaffirmée, Jean-François Bayart apporte, dans ce petit livre reprenant un article paru précédemment dans la revue Le Débat, un démenti tout à la fois cinglant et salutaire.
Cinglant car ne se contentant pas de la posture de l’accusé contraint à se défendre, il passe à l’offensive et souligne le caractère tout à la fois confus et dangereux des études postcoloniales telles qu’elles sont présentées et utilisées par leurs promoteurs français. Salutaire car ne se contentant pas de critiquer, il ouvre des pistes qui permettent d’esquisser les contours d’un usage scientifique du postcolonial aux vertus heuristiques plus prometteuses que celles de l’usage essentiellement politique qui en a jusqu’à présent été fait en France. Autant qu’un appel de plus à « en finir avec les études postcoloniales » – titre de l’article qui a donné naissance au présent livre, on peut donc tout aussi bien y voir la première pierre d’une nécessaire refondation de celles-ci sur des bases certes moins grandiloquentes, mais avant tout plus solides et assurément plus fructueuses pour la recherche historique. C’est en ce sens que J.-F. Bayart, loin de chercher à évacuer le questionnement postcolonial, peut affirmer que « la révolution copernicienne qu’entendaient incarner les postcolonial studies est encore devant nous » (p. 97).
La critique des études postcoloniales, pour être un exercice répandu en France, s’avère d’autant moins aisée que les contours et la nature de celles-ci sont des plus incertains. Sous une même étiquette, on trouve en effet des projets forts différents. Pour certains, le postcolonial est d’abord un moment : c’est l’étude de ce qui vient après le colonialisme (titre de la traduction française de Modernity at large d’A. Appadurai). Pour d’autres, il s’agit plus précisément de débusquer ce qui survit du colonialisme dans un monde officiellement décolonisé, de repérer en nous la persistance dissimulée de cet « ennemi intime » (A. Nandy). Mais la démarche peut aussi être rétroactive et extensible à l’infini : le postcolonial est alors présenté comme une entreprise qui vise à aller au-delà du colonialisme en déconstruisant l’impensé colonial et la « violence épistémique » (G. C. Spivak) qu’incarnerait de longue date l’Occident. Une telle logique permet à ces théoriciens de débusquer du colonial partout : « chez les Palestiniens, naturellement, en butte au « colonialisme », voire au régime d’apartheid sioniste, mais aussi (chez) les Gastarbeiter turcs en Allemagne (eux aussi) censés relever d’une situation « postcoloniale » bien que la « colonialité » d’Israël fasse débat et que la Turquie ne fut jamais colonisée » (p. 17). Aussi pour J.-F. Bayart, le seul dénominateur commun à ce champ de recherche hétérogène ne serait autre que « sa posture de dénonciation » (p. 18) et sa systématique « stigmatisation de l’arriération française » dans laquelle il décèle « une stratégie de niche de la part de chercheurs en quête d’une part de marché académique ; une forme de coquetterie à mi-chemin du snobisme américanophile et du masochisme hexagonal » (p. 37).
A supposer cependant qu’on veuille bien reconnaitre une cohérence et une légitimité à la démarche postcoloniale en sciences sociales, on ne peut qu’être dubitatif face à l’accusation sans cesse réitérée d’indifférence de la recherche française à son égard. L’accusation ne revient-elle pas en effet « à blâmer un adulte qui avait contracté une primo-infection dans son enfance de ne pas être devenu tuberculeux à l’âge mur » (p. 20) ? Sans même parler de l’influence séminale de la French theory sur les penseurs du postcolonialisme, on ne peut que constater que les écrits d’un Frantz Fanon sur la psychologie antillaise ou d’un Aimé Césaire sur la « décivilisation du colonisateur » avaient dès les années 1950 largement exploré les problématiques aujourd’hui présentées comme novatrices des postcolonial studies anglo-saxonnes. Et que dire de la virulence de la préface de Jean-Paul Sartre aux Damnés de la terre qui ferait presque passer G. C. Spivak « pour une demoiselle d’honneur » (p. 21). Loin de faire preuve d’une quelconque allergie aux études postcoloniales, la pensée française en fut au contraire très largement l’initiatrice, ce qui explique son peu d’enthousiasme actuel face à son retour tonitruant, mais finalement de seconde main, en langue anglaise. Si rejet il y a eu, il fut non pas épidermique mais réfléchi, et résulte tout simplement d’une évaluation globalement négative de l’apport scientifique concret de ce courant intellectuel : si elles ne sont pas dénuées d’intérêt, « force est de reconnaître que, dans leur utilité, les postcolonial studies sont superflues. La plupart des problématiques qu’elles ont explorées l’ont simultanément ou préalablement été par des courants autres, qui ont souvent su, par ailleurs, éviter les écueils sur lesquels elles se sont échouées » (p. 41). Pire encore, par leurs excès et leurs approximations, les études postcoloniales présentent un risque réel de « régression scientifique par rapport aux acquis de ces trente dernières années » (p. 43).
En effet, obnubilées qu’elles sont par la déconstruction des « représentations » et des « discours » coloniaux, les études postcoloniales en viennent à s’éloigner des réalités concrètes et nécessairement complexes du phénomène colonial lui même, dont elles négligent en premier lieu le caractère pluriel : « les situations coloniales se sont déclinées sur des modes très différents, que confondent les postcolonial studies. Celles-ci ne font généralement pas de distinction entre les colonies de peuplement ou les colonies esclavagistes et les autres (…). On n’est pas colonisé, et donc « postcolonisé » de manière identique dans les Caraïbes et en Inde » (p. 46). De même le colonialisme est présenté par elles comme une spécificité occidentale, négligeant de ce fait l’analyse de ses formes nippones ou ottomanes, ou encore de la manière dont des populations européennes (Irlandais ou Chypriotes par exemple) ont pu en être les victimes tout autant que les agents. Péchant par « nonchalance sémantique » (p. 51), les études postcoloniales construisent ainsi une colonie et un colonisé idéels et anhistoriques, plus au service de leurs usages politiques actuels que de la compréhension scientifique de leur réalité passée : ainsi, « en France, les Indigènes de la République inventent la colonie de leurs cauchemars, et aussi de leurs rêves, c’est-à-dire de leur combat contre l’exclusion, l’injustice sociale, le racisme ordinaire. Ce mythe de la postcolonial nationhood, qui a ses équivalents en Inde et en Amérique latine, est politiquement légitime. Mais il ne nous dit rien de ce que fut le moment colonial » (p. 98). Prétendant déconstruire les représentations essentialisantes de l’autre produites par l’Occident, les études postcoloniales ne font le plus souvent que leur en substituer de nouvelles. Non sans risque ni contradictions, « elles s’enferment dans le concept catastrophique d’ « identité » et réifient une condition postcoloniale à laquelle elles confèrent un statut quasi ontologique (…). En France, elles contribuent à ethniciser la question sociale et politique des banlieues et à poser en termes exclusifs de racisme ce qui relève aussi de la « lutte des classes » au risque de s’ériger en prophétie autoréalisatrice. Et en Afrique, elles n’aident pas à sortir le problème de l’esclavage de l’ordre du discours nationaliste, qui occulte les rapports serviles internes aux sociétés subsahariennes et rabat le legs de la traite sur la dénonciation univoque de l’Occident » (p. 45).
Autant qu’aux études postcoloniales elles-mêmes, c’est donc à leurs usages politiques, particulièrement en France, que s’attaque J.-F. Bayart : « là où les subalternistes indiens s’en prenaient à la dépendance épistémique du tiers-monde et peut-être surtout au nationalisme et à l’historiographie nationaliste en tant qu’avatars du colonialisme, là où les cultural studies nord-américaines prolongent l’interprétation postmoderne de la globalisation, les tenants français des études postcoloniales ont tendance à les cantonner à une critique très franco-française de la République, de la genèse de la citoyenneté et du legs colonial. Ils restent ainsi dans l’épure d’un narratif national, quitte à l’inverser » (p. 38). Or un autre usage du postcolonial est possible qui « doit partir de l’original plutôt que de la copie, et d’abord porter sur ce qu’elles ont à nous dire de l’histoire du fait colonial en tant que tel, de l’historicité du rapport que nous entretenons aujourd’hui avec lui, dans notre monde dit « global », et de l’historicité de la mondialisation elle-même» (p. 39). Ce n’est donc pas le projet postcolonial mais l’essentiel de ses réalisations qui sont à rejeter : « l’intuition des postcolonial studies quant à l’enchaînement, sinon la continuité, du colonial au postcolonial semble convaincante, mais la démonstration est fausse, quand elle n’est pas absente ou inquiétante à force de tourner le dos aux règles de méthode les plus élémentaires des sciences sociales » (p. 65).
Esquissant les prémisses de ce que pourrait être un bon usage des études postcoloniales, J.-F. Bayart invite à replacer l’histoire de la colonisation dans la perspective plus globale d’une histoire de l’impérialisme, dont elle n’est finalement qu’une des formes : « le vrai débat de sociologie historique comparée qu’appelle la colonisation est celui qui a trait aux conditions de passage de l’empire à l’Etat-nation. Notamment à la relation synergique entre la globalisation et l’Etat-nation aux XIXe et XXe siècles et au rôle d’incubateur de l’Etat-nation que tient l’empire, dans sa version coloniale comme dans ses configurations classiques, par exemple ottomane, habsbourgeoise ou russo-soviétique » (p. 68). En inscrivant ainsi le phénomène colonial dans la longue durée et dans l’espace global, on mesure mieux sa contingence (la colonisation a parfois été tout aussi superficielle que brève) et par là même le paradoxe « entre le pouvoir de surdétermination que les postcolonial studies attribuent au moment colonial et l’inconsistance ou la fragilité de ses avatars historiques » (p. 74). Ce faisant, on redonne toute sa place à la capacité d’initiative (agency) des colonisés (que les études postcoloniales réduisent trop souvent à « un rituel d’affliction plus ou moins doloriste et morbide », p. 54) en tenant compte du fait qu’un empire repose « sur la cooptation autant que sur l’occupation, et sur l’adhésion autant que sur la soumission » (p. 78). Un postcolonialisme conséquent ne réifie donc pas le colonisé ou le postcolonisé en une figure abstraite d’éternelle victime d’un Occident seul à même d’écrire (à tous les sens du terme) l’histoire, mais reconnaît au contraire sa capacité de décision et d’action, et œuvre à analyser celle-ci dans toute sa complexité : « là où les postcolonial studies déclinent le fait colonial au singulier et l’enferment dans un rapport exclusif du colonisé à son colonisateur et à sa métropole, prévaut en fait l’évidence de sa multidimensionnalité » (p. 83). Dit autrement, on ne comprend rien au fait colonial en le réduisant à la « vision statique et binaire d’un tête-à-tête, réifié en essence, entre le colonisateur et le colonisé, sous la forme d’un jeu à somme nulle plus ou moins dramatique et toujours a-historique ». Il faut au contraire, en l’inscrivant dans le cadre des recherches d’histoire impériale et en s’inspirant des méthodes de l’histoire connectée, penser l’empire non comme « une roue dont les rayons ramèneraient au centre, les périphéries ne communiquant qu’avec celui-ci ou par son intermédiaire » (p. 85), mais comme une « chambre d’écho » au sein de laquelle résonnent et circulent, et pas nécessairement en sens unique, « idéologies, modèles administratifs, croyances religieuses, marchandises, techniques du corps, hommes de sciences et de foi, fonctionnaires et marchands » (p. 86).
A la lecture de Jean-François Bayart, on comprend donc que s’il faut bien en finir avec quelque chose, ce n’est pas tant avec le questionnement postcolonial lui même qu’avec ce qui en a le plus souvent été fait jusqu’à présent, singulièrement en France, à savoir un simple exercice de traque et de déconstruction des formes d’hégémonie occidentale sur le vaste monde, méthode qui revient paradoxalement à confirmer et la séparation essentialisante entre « eux » et « nous », et la centralité de l’Occident, qu’on prétend pourtant toutes deux contester. Plutôt que d’être réduit à une domination à sens unique exercée par un centre sur ses périphéries, le phénomène (post)colonial gagne à être analysé sur la longue durée et à l’échelle globale, comme une forme de connexion à sens multiples entre différents pôles en interactions. Le malheur des études postcoloniales, en France plus encore que dans le reste du monde, tient au fait qu’elles ont été accaparées par des groupes militants qui en ont fait un instrument de lutte à usage interne -la critique du « modèle républicain » français dénoncé comme une continuation du colonialisme- alors qu’elles auraient pu au contraire servir de tremplin à un décloisonnement des programmes de recherche. Le récent regain d’intérêt des historiens français pour l’histoire globale témoigne cependant du fait que, de manière certes moins tonitruante, une autre réception des postcolonial studies, plus sérieuse, plus prometteuse et espérons-le plus durable, est également à l’œuvre.
Florian Louis est agrégé d’histoire. Il mène des recherches en historiographie à l’EHESS (CRH).
Tous beaux et bons ? Travail et politique dans l’Athènes classique par Pablo Martin Paneda
A propos de Saber Mansouri, La démocratie athénienne, une affaire d’oisifs ? (IVe siècle av. J.-C.), André Versailles, mars 2010.
Lorsqu’il soutient sa thèse en 1933, François Ollier évoque l’enracinement dans les mémoires collectives d’un « mirage spartiate ». Nombre de documents révèlent davantage la pensée des Anciens sur cette polis qu’ils n’évoquent la réalité, plus nuancée. C’est un peu à un mirage athénien que s’attaque Saber Mansouri, enseignant à Paris VII, dont la thèse porte précisément sur le travail dans l’Athènes du IVème siècle. Platon, Xénophon et Aristote, cristallisent l’idéal politique d’une élite restreinte. Ils ne reflètent guère –du moins directement- les pratiques réelles de la cité. Or, pour qui s’attarde à lire entre les lignes les auteurs les plus classiques, pour qui a la curiosité de varier les sources utilisées, une autre image se profile. La pratique de la citoyenneté n’est pas l’exclusivité des oisifs. Ce serait ignorer la foule de petits commerçants et d’artisans, mais aussi de métèques et d’esclaves qui participent à l’effervescence de l’école de la Grèce. Le sort de cette Athènes populaire, voire populeuse, semblait scellé d’avance. Et par les plus grands, par Aristote, rien de moins. Celui-ci distingue quatre critères qui confèrent à un individu un ascendant sur l’agora : richesse, naissance, valeur, éducation (Politique, 1291b). Pauvre travailleur.
Artisan ? Qu’il soit céramiste, potier ou forgeron, qualifié avec mépris de banausos parce que son travail quotidien auprès du feu est supposé altérer ses facultés mentales, il n’a décidément pas les capacités pour manier le discours, l’abstraction et la raison. Pauvre métèque, intégré économiquement, civiquement marginal. Pauvre esclave enfin, outil animé, simple corps guidé par l’esprit du maître, homme libre doté de raison –Aristote encore, Politique, livre I, chapitres 4 à 7. Travailleurs, métèques, esclaves. Qu’entendent-ils aux discussions élevées qui président aux destinées du démos ? Par-delà cette lecture –lacunaire- des penseurs antiques, forces et faiblesses de la démocratie athénienne émanent aussi des strates les plus humbles. N’en déplaise aux kaloi kagatoi, la politique n’est pas réservée aux oisifs. D’autres peuvent la pratiquer. Si ce n’est à loisir, du moins de temps à autres. Le livre de M. Mansouri s’avère être une entreprise intéressante qui comporte quelques traits positifs. Toutefois, le lecteur reste sur sa faim, éprouve un sentiment d’inachevé.
Les développements les plus récents de l’historiographie sur la Grèce ancienne tendent à développer des études moins focalisées sur une cité en particulier, davantage ciblées sur des thématiques transversales englobant, sur un temps long, des communautés hétérogènes gravitant autour d’un bassin méditerranéen élargi. Loin de ces approches nouvelles, l’auteur décide d’ausculter Athènes à son apogée, entreprise louable mais risquée, puisque située sur un terrain maintes fois ratissé. Néanmoins, l’historien entend poser sa marque. A cette fin, il définit clairement un projet qui échappe aux débats économiques entre primitivistes et modernistes. Cet ouvrage creuse l’histoire du fait politique dans la cité classique, mais il s’appuie pour cela –et c’est pourquoi la démarche captive- sur les apports de l’histoire économique.
De nouveaux horizons s’ouvrent. Il s’agit de rendre compte d’une « autre politique (…) complémentaire, voire parallèle » à la politique institutionnelle classique étudiée traditionnellement, capable de peser sur celle-ci. Engendrée au sein de groupes qui « se formaient dans certains ateliers pour discuter, échanger des nouvelles, critiquer un vote ou un jugement » (p.20). L’état des sources rend bien évidemment difficile l’étude de ces débats politiques informels, par définition spontanés, oraux, sans traces. Vivre le débat public au quotidien, c’est déjà s’intégrer à l’espace public. L’auteur inclut, en toute logique, les étrangers. Ils ne jouissent pas de la citoyenneté de leurs hôtes, mais ils partagent l’intégralité du fait civique, par temps de paix comme par temps de guerre. De fait, une séparation rigide entre citoyens et non-citoyens s’avère peu opératoire, suffisamment réductrice pour être abandonnée dans le cadre d’une étude globale du phénomène démocratique.
Opération de démolition des clichés, l’ouvrage a aussi le mérite, comme le souligne d’ailleurs Claude Mossé dans la préface, de rompre avec l’insubmersible partition entre homo oeconomicus des économistes rationalistes et l’homo politicus weberien. Le citoyen athénien n’est pas un homo politicus éthéré, détaché des enjeux matériels. Kapélos –petit marchand- et métèque ne sont point de purs affairistes enclins seulement à compter leurs oboles et leurs drachmes. Ils s’intéressent aussi à des causes de plus grande envergure. Toutefois, il serait simplificateur de conclure à l’existence d’acteurs à la fois économiques et politiques –pleinement et simultanément. Une réalité humaine composite et mouvante ne peut être saisie dans le rets de grilles de lecture binaires. En ce sens, l’ouvrage abonde d’exemples concrets de trajectoires individuelles qui tissent des passerelles entre le Pirée et la Pnyx.
A ce titre, parmi les passages intéressants, l’évocation des « marchands en mer », pour reprendre l’expression de Sophocle mentionnée par l’auteur, s’avère édifiante (p.183). Le commerce maritime est source d’information, voire de rumeurs, dans le monde antique. Et cela, qu’il soit réalisé par des ressortissants athéniens jouissant de la plénitude des droits civiques ou par des non-citoyens. Même le plus humble marin de la cité configure, de manière plus ou moins directe et à plus ou moins grande échelle, l’échiquier politique athénien. Qu’il s’agisse d’information ou de désinformation, il oriente, canalise et configure l’imaginaire social. Il structure le débat public. Aussi le métèque ne vote-t-il sans doute pas, mais il se révèle fréquemment comme l’intermédiaire par lequel les conjectures sur l’outre-mer s’échafaudent. Toutefois, cet étranger accueilli par Athènes peut aussi s’impliquer de façon nettement plus tangible.
Le diptyque hérité est désormais canonique. D’une part, le mauvais métèque. Il ne s’attarde pas dans Athènes, il désire s’enrichir puis partir. D’autre part, le bon métèque, désireux de s’engager aux côtés des citoyens athéniens et disposé à partager leur sort, y compris dans les moments les plus dramatiques. « Athéniens sans l’être vraiment » précise M. Mansouri (p.198) – heureuse formule empruntée à Nicias. Nombreux sont les métèques qui sont aux côtés de Thrasybule pour renverser la tyrannie des Trente en 403. Bien sûr, tout n’est pas qu’altruisme. Thrasybule a promis aux métèques qui épousent sa cause l’obtention du droit de cité. Outre la reconnaissance symbolique que cela implique, il ne faut pas sous-estimer l’attrait financier d’une telle promesse : ne plus acquitter le métoikon, cette taxe de séjour qui correspond à une journée de travail par mois pour les hommes et une demi-journée pour les femmes. Ainsi, l’attitude des élites à l’égard des catégories laborieuses n’est pas monolithique. L’ambiguïté des comportements est reflétée par la diversité des substantifs, oscillant entre une image fréquemment négative et une reconnaissance ponctuelle. Le potier n’est pas qu’un banausos usé par le feu. Au gré des écrits, il peut aussi être désigné comme un technitès, voire un démourgos, vocables plus positifs. Le premier privilégie l’identification par le savoir-faire, tandis que le second entend rappeler que l’artisan, démiurge à petite échelle, déploie une activité créative au service de la communauté. Le monde marchand suscite également des visions multiples. L’emporos, marchand au long cours, est plutôt respecté car il exerce une influence à l’échelle régionale. Le kapélos, petit commerçant dont le rayonnement n’échappe guère à l’échelle locale de son petit étalage, est davantage négligé.
Variété des termes, variété des pensées. M. Mansouri reprend des lectures nuancées de Platon, Xénophon et Aristote. Platon est sans doute le plus ferme à l’égard des artisans et des commerçants. Ces « deux catégories forment l’ailleurs de la politique » (p.63) quel que soit leur rang, du plus modeste artisan à l’affairiste puissant. La réflexion aristotélicienne détient davantage de teintes. Moins catégorique car plus historique, Aristote méprise le travail manuel aux antipodes de sa conception de la sphère politique, néanmoins il « admet que les artisans et les commerçants soutiennent la démocratie car ils sont intégrés à la communauté civique », notamment par le biais des différents misthoi, ces indemnités de fonction au citoyen ou au magistrat qu’Athènes reverse à ceux qui s’investissent dans son avenir. La pensée la plus riche revient à Xénophon. Comme le souligne Saber Mansouri, derrière ces attitudes différentes, inutile de voir des positions contradictoires. Simplement, l’objet du propos et le contexte de rédaction de l’œuvre changent. L’Economique évoque l’idéal du propriétaire exploitant. A l’échelle de la maisonnée, cet ouvrage mêle conseils agricoles et préceptes de gestion des affaires domestiques, « le lien entre le citoyen et la propriété foncière » demeure socle de la citoyenneté athénienne (p.106). En revanche, les Poroi préconisent des idées novatrices. Dernier ouvrage de Xénophon, rédigé en 355, c’est-à-dire après l’échec de la seconde ligue de Délos et la fin définitive de l’hégémonie athénienne, il s’agit de perpétrer l’effervescence athénienne non plus par l’impérialisme, mais par le pragmatisme. Une des thèses les plus originales, c’est de prôner l’intégration sociale des métèques afin de consolider la fonction commerciale d’Athènes. Autre mesure préconisée, louer des esclaves publics aux concessionnaires des mines du Laurion. Si bon nombre des recommandations de Xénophon sont restées lettre morte, Saber Mansouri rappelle que certaines d’entre elles ont germé. De fait, à partir du gouvernement d’Eubule, les fameuses mines argentifères connaissent un regain d’activité car ces exploitants disposent de certains avantages fiscaux. Par ailleurs, les décrets mettant à l’honneur les métèques se multiplient. Néanmoins, l’intégration des étrangers comporte des limites, comme le prouve l’étude du droit d’enktésis. Xénophon accepte volontiers de concéder au métèque un droit de propriété afin d’acquérir un logement, une boutique, un atelier ou un entrepôt. Mais, ce faisant, il cantonne les métèques au monde urbain. Acquérir des terres de culture, cela est exclu, tant il s’agit d’une prérogative définissant l’identité même du citoyen athénien (p.108).
On pourrait revenir sur de nombreux passages de l’ouvrage, qui aborde des thèmes variés avec un effort de périodisation de l’histoire athénienne. Si elle n’est pas centrale, cette périodisation s’avère néanmoins sous-jacente entre un cinquième siècle florissant et un quatrième siècle perçu –à tort ou a raison, et selon les domaines- comme décadent. Le principal problème, c’est que l’auteur n’apporte rien de vraiment neuf ici. Les étudiants ayant fait quelque peu d’histoire grecque avec rigueur ne seront pas bouleversés par cette lecture. Certes, quelques passages forts nuancés et séduisants, ont le mérite, encore une fois, de combattre les préjugés et les clichés à travers lesquels le lecteur contemporain conçoit l’antique isonomie. Si ce livre recentre l’historiographie, il ne la renouvèle point. Fait révélateur –et, sans doute, faiblesse rédhibitoire- de nombreuses pages se contentent de citer, de mettre en perspective de longs extraits de travaux antérieurs. M. Mansouri fait appel à un large spectre de travaux, allant jusqu’aux analyses les plus récentes, telles celles d’Alain Bresson. A l’inverse, certaines considérations s’enlisent, citent des articles certes décapants en leur temps, mais fort familiers, voire consensuels désormais. Ainsi, M. Mansouri met en garde contre une « généralisation risquée qu’inspirent la lecture excessive et la validation des aristoi ». On ne peut qu’acquiescer. D’autant plus que cette sentence intervient au sujet des réflexions de Gustave Glotz. Cet éminent historien affirmait, au cours de l’entre-deux-guerres, que les Athéniens renoncent tous, dès qu’ils le peuvent, aux affaires privées pour se consacrer à la politique. Et sur quoi se fonde cette critique si peu novatrice de Gustave Glotz ? Sur un article signé Rodolfo Mondolfo, daté de 1954, et publié dans la célèbre référence anglo-saxonne Past and Present fondée deux ans auparavant. C’est un exemple parlant, un exemple parmi beaucoup d’autres. M. Mansouri cite, récite et contre-cite pour étayer son propos. En soi, cette pratique bien évidemment honorable garantit le sérieux et la profondeur du propos. Mais M. Mansouri n’ajoute pas sa propre pierre à l’édifice. Il suit de là que l’apport historiographique de ce livre s’avère, en définitive, assez maigre.
Pire, non seulement l’analyse s’appuie sur de trop longues et de trop nombreuses citations historiographiques, mais elle sombre dans un autre écueil encore plus pesant pour le lecteur : l’accumulation d’exemple, telles les trop longues pages consacrées à l’évocation des concessionnaires miniers ayant des activités politiques à Athènes. Si quelques considérations sur Hypéride (p.170-171) sont bienvenus, on peut en revanche déplorer l’effet catalogue d’une trop longue énumération de personnages évoqués de la page 168 à la page 174. Les annexes existent ! Les spécialistes n’apprendront rien, et les non-spécialistes seront ravis d’apprendre qu’Epicratès, fils de Pallenéos, est propriétaire d’un atelier dans les mines de Laurion, mais aussi ambassadeur à Byzance en 378/377 (p.170). Le souffle historique s’étiole, se mue en exemplier.
La nature hybride de l’ouvrage joue en sa défaveur. Assurément pas un essai, puisqu’il ne propose par une lecture nouvelle de la démocratie dans l’Athènes classique. Pas un manuel non plus. Ce serait là une fonction qu’il pourrait remplir correctement, toutefois il ne s’affirme en tant que tel. Si tel avait été le cas, on aurait pu lui reconnaître le mérite de fournir nombre d’exemples et de travaux historiographiques. Ce n’est pas une production de vulgarisation non plus, du moins pour non-hellénistes, comme l’indique le choix de laisser les termes étrangers dans l’alphabet grec. Enfin, la très grande majorité des exemples sont plus que classiques, et l’exploitation en demeure banale. Pas seulement les Périclès, Nicias, Démosthène et autres Cléophon, mais aussi les éternels banquiers Pasion et Phormion. Bien évidemment, on ne gagne jamais rien à coller des étiquettes, et ce précepte s’applique aussi aux livres. Pourtant, l’absence d’une nature clairement définie s’avère ici dommageable car l’ouvrage risque d’avoir du mal à trouver son public. Il risque de frustrer néophytes comme spécialistes. D’autant plus qu’il donne, globalement, une impression d’inachevé. Ce n’est qu’un détail et les coquilles arrivent à tout le monde, mais cette édition s’achève sur une faute d’accord au mot ultime, celui qui précède immédiatement le point final. Triste conclusion. D’autant plus triste qu’elle manque de portée. Elle se contente de récapituler, par le biais de plusieurs redites, ce qui a déjà été affirmé au fil des chapitres.
Il est regrettable que la démarche initiale proposée par M. Mansouri, si intéressante, ne soit pas exploitée et assumée jusqu’au bout. Puisque l’auteur entend multiplier les sources afin d’échapper aux discours émanant de quelques beaux-esprits que nous a légués l’école de la Grèce, le lecteur serait en droit d’attendre, par exemple, une étude iconographique de la céramique attique jusqu’à nos jours. Ces poteries sont riches d’enseignements –et de clichés, on en convient- sur les différents corps de métiers. De même, dans une cité telle qu’Athènes, les huit dixièmes environ de la valeur créée par la production athénienne est d’origine agricole. S’intéresser aux artisans, aux métèques qui font du commerce, aux esclaves, c’est étudier des franges centrales de la population certes beaucoup plus nombreuses que les quelques aristocrates qui ont modelé le discours dominant. Et pourtant, c’est encore se consacrer à des groupes minoritaires. Trop centrée sur l’asty, le foyer urbain d’Athènes, l’analyse aurait pu être plus large. Pourquoi ne pas avoir exploré les environs campagnards, cette chôra qui fait partie intégrante d’Athènes ? Car même si artisans, esclaves et métèques n’ignorent pas le monde rural, c’est une étude trop centrée sur la pratique politique urbaine que propose ici M.Mansouri. Alors même qu’il consacre des passages intéressants sur le lien entre citoyenneté et territoire par le prisme du rapport à l’espace habité, l’auteur n’entreprend pas de comparaison entre le travailleur urbain et le travailleur rural. Mogens H. Hansen l’explique fort bien, la démocratie athénienne repose sur un idéal de démocratie directe, mais dans les faits de rouages plus complexes. Il n’en demeure pas moins que circonscrite sur un territoire restreint, la cité-Etat jouit de centres névralgiques géographiquement proches du plus grand nombre. Elle peut compter sur la participation égale de tous les dèmes au débat public -théoriquement du moins. Pourtant, a priori, la perception des enjeux ne se révèle pas forcément identique pour les travailleurs ruraux et pour les travailleurs urbains. Du moins la question peut être posée. Bien sûr, une telle étude se heurterait à la rareté des sources. Nonobstant elle aurait pu ébaucher quelques pistes rafraîchissantes. Au mieux, l’ouvrage de M. Mansouri propose de faire le point. Point de renouveau.
Pablo MARTIN PANEDA est agrégé d’histoire, il est allocataire-moniteur à l’université Paris IV – Sorbonne.
Une histoire totale du Tiers Monde, par Noël Bonhomme
À propos de Vijay Prashad, Les nations obscures, une histoire populaire du Tiers monde, Montréal (trad.), Ecosociété, 2009.
Si la colonisation et la décolonisation font l’objet d’abondants travaux, peu d’ouvrages généraux sont disponibles en français sur la période postcoloniale, et plus rares encore sont ceux qui prétendent embrasser l’histoire de l’ensemble des Etats décolonisés depuis leurs indépendances. Le travail de Vijay Prashad offre une synthèse inédite à la fois par son ampleur géographique et temporelle, et par sa volonté de faire une histoire du Tiers monde en soi, en tant que projet et pas seulement en tant qu’ensemble disparate de pays. Cet ouvrage, traduction d’un livre publié en 2007 aux États-Unis, a l’ambition de trancher avec une histoire contemporaine souvent occidentalo-centrée (d’où le titre de « nations osbcures »), et de faire une histoire totale du Tiers monde, à la fois politique, géopolitique, sociale, culturelle et intellectuelle. Plus que l’histoire des Etats indépendants, c’est l’histoire des peuples que l’auteur a l’ambition de faire – d’où le sous titre « histoire populaire du Tiers monde », qui fait écho au célèbre livre d’Howard Zinn, mentor de Prashad et éditeur de son ouvrage.
D’emblée, il écarte l’idée que le Tiers monde n’ait été qu’un ensemble disparate d’États n’appartenant ni au monde communiste, ni au monde occidental: « Le Tiers monde n’était pas un lieu. C ‘était un projet » (p 9). Ce projet, né de la décolonisation consistait à rendre les nouveaux États indépendants à tout point de vue: « Projetées entre les deux grands blocs, les nations obscures se regroupèrent au sein du Tiers monde. Ces peuples volontaires combattaient le colonialisme et réclamaient leur liberté. Ils exigeaient l’égalité politique à l’échelle mondiale, avant tout par la voix de l’ONU. […] Leurs demandes dépassaient la simple égalité politique: le projet du tiers monde impliquait une redistribution des ressources mondiales, un meilleur revenu pour la force de travail de ses peuples, et une reconnaissance générale de ses héritages scientifiques, technologiques et culturels. […] Le projet du Tiers monde toucha des millions de personnes et forgea bien des héros. Ils étaient grisés par les visions d’avenir que portait le Tiers monde. Son projet unissait des camarades dissemblables. » (p 10-11). Vijay Prashad fait donc l’histoire intellectuelle du projet tiers-mondiste dans toutes ses dimensions et ses implications : le non alignement bien sûr, mais aussi les réformes sociales, l’organisation économique, l’émancipation des femmes ou encore la réhabilitation des cultures des peuples décolonisés. En dépit de la diversité, voire de l’éclectisme du tiers-mondisme, ce projet a pour l’auteur une réelle unité organique: c’est un projet résolument progressiste (au sens où il est tourné vers l’avenir et vise à construire un monde nouveau), laïc et socialiste.
A partir de cette définition, la démarche du livre est d’expliquer comment ce projet généreux a échoué, en raison à la fois de facteurs internes et externes. Prashad parle du Tiers monde au passé: c’est la naissance, la vie et la mort d’une idée qu’il raconte, de manière dialectique et presque tragique, comme le montre l’enchainement des trois parties du livre: « la quête » du Tiers monde, ses « écueils », et enfin son « assassinat ». Son analyse aux accents marxistes défend une thèse engagée et univoque: le projet du Tiers monde a échoué d’après lui parce que les classes sociales dominantes des sociétés décolonisées l’ont confisqué à leur profit et vidé de sa substance, puis l’ont abandonné purement et simplement en associant leurs pays à la mondialisation libérale des années 1980. Le projet du Tiers monde aurait donc échoué pour être demeuré au stade de révolution inachevée, ou d’ébauche de révolution:
« Le projet était vicié dès le départ. La lutte contre les forces coloniales et impériales avait exigé l’unité des divers partis politiques et classes sociales. Les formations politiques et les mouvements sociaux qui avaient libéré les nouvelles nations et conquis le pouvoir bénéficiaient alors d’un large soutien populaire. Une fois en place, l’unité jusque là préservée coûte que coûte devint problématique. La classe ouvrière et la paysannerie favorable à ces mouvements avaient généralement accepté de faire alliance avec les propriétaites terriens et les élites industrielles émergentes. Le peuple enfin maitre de la nouvelle nation attendait que l’Etat mette en place un programme socialiste. C’est en fait un compromis idéologique qu’il obtint – tantôt nommé socialisme arabe, socialisme africain, Sarvodaya ou NASAKOM -, combinant promesses d’égalité et maintien de la hiérarchie sociale. Au lieu de se donner les moyens d’édifier une société entièrement nouvelle, ces régimes protégeaient les élites des ancienne classes sociales tout en créant des programmes sociaux pour le peuple. Une fois au pouvoir, les anciennes classes sociales s’imposèrent, soit par le biais des instances militaires, soit par le biais du parti populaire ayant conduit à la victoire. […] Dans les années 1970, les nouvelles nations n’étaient plus si nouvelles. Elles aveint accumulé les échecs. Les revendications populaires – terre, pain , paix – avaient été ignorées au bénéfice des classes dominantes et de leurs besoins. Les luttes intestines, le manque de contrôle sur les prix des matières premières, l’asphyxie financière impossible à éviter et d’autres facteurs expliquent l’apparition d’une crise budgétaire dans bien des pays du tiers monde. Les banques commerciales ne consentaient de prêts que si les Etats acceptaient de signer un contrat « d’ajustement structurel » avec le FMI et la Banque Mondiale. L’assassinat du tiers monde a rongé l’aptitude de l’Etat à agir au nom de la population, a mis fin à l’espoir d’un nouvel ordre économique international, a poussé au reniement des idéaux socialistes. Les classes dominantes, autrefois attachées au projet du tiers monde, coupaient maintenant les ponts. Elles ne se voyaient plus comme partie prenante du projet, mais comme des élites – le patriotisme du bénéfice net supplantait la solidarité obligatoire. Le projet du tiers monde s’effrondra, laissant place à l’essor d’un nationalisme culturel dans les nations obscures ».
Un livre engagé et polémique, donc. Il postule que le cœur du projet tiers-mondiste était la construction d’une nouvelle société, une sorte de révolution sociale dont la révolution politique constituée par l’indépendance des nouveaux États n’aurait été que l’amorce (« L’absence de révolution sociale eut pour conséquence importante la persistance d’une hiérarchie, sous diverses formes, au sein des nouvelles nations. L’inculcation du sexisme, la stratification inégalitaire fondée sur le clan, la caste ou la tribu, entravèrent le projet politique du Tiers monde », p 27): le projet de Tiers monde qu’il définit comme référence est pur, cohérent, idéal, et pour tout dire idéaliste. Or, l’auteur lui-même le rappelle à de nombreuses reprises, ce projet a été bâti et défini par des hommes aux horizons politiques différents, qui pouvaient être aussi bien nationalistes que communistes, alliés aux Occidentaux ou aux Soviétiques, religieux ou laïcs, démocrates ou autocrates. Le Tiers monde était un projet progressiste, mais il était aussi multiple, foisonnant, pétri de contradictions, et par là même capable de transcender les clivages politiques et idéologiques classiques: par essence, il était donc un compromis et n’avait pas nécessairement la cohésion idéologique que Vijay Prashad lui prête.
Les sources qu’utilise l’auteur ne sont pas sans incidence, de ce point de vue. Sa synthèse s’appuie d’une part sur une impressionnante bibliographie, d’autre part sur des sources primaires qui sont essentiellement des ouvrages, discours ou propos des grandes figures historiques du Tiers monde, figures politiques (Nasser, Nehru, Nkrumah, Sukarno, Che Guevara, etc), économiques (l’économiste argentin Raul Prebisch), culturelles ou intellectuelles (Fanon, Césaire, Senghor…) dont le discours tend naturellement à gommer les aspérités et les contradictions du Tiers monde. Dans cette histoire « populaire » du Tiers monde, on n’entend en fait que rarement la voix des « peuples », du moins de manière directe. Par contre, dans la rhétorique tiers-mondiste qu’épouse le livre, on a volontiers tendance à parler au nom des « peuples ». S’il ne fait certes aucun doute que le projet du Tiers monde a été soutenu de manière massive et enthousiaste par les populations décolonisées, l’histoire que fait Vijay Prashad est avant tout celle du discours du Tiers monde et des politiques suivies par ses États. L’histoire assez classique d’un projet politique, finalement moins hors des sentiers battus que son titre ne le laisse penser.
Aussi le livre n’est-il pas exempt de manichéisme dans sa manière de tracer une ligne de séparation stricte entre ceux qui soutiennent le projet socialiste du Tiers monde (les « peuples ») et ceux qui le mineraient de concert avec le monde occidental (les « classes dominantes » ou « élites traditionnelles »). Le Tiers monde n’est évidemment pas à équidistance entre les deux autres, puisqu’il s’est construit en réaction au colonialisme occidental, et avec la contribution des mouvements communistes: si le premier monde se voit reprocher son « impérialisme », le second (le monde communiste) se voie juste reprocher son manque de soutien et son désintérêt pour le projet tiers-mondiste. Opinion pertinente, mais émaillée parfois d’affirmations douteuses: on lit par exemple avec perplexité que la guerre de Corée serait une « agression américaine » (p 44), que « la participation de l’URSS à la tradition des coups d’État est en fait remarquablement limitée » (p 186), ou encore que les États-Unis et le dollars auraient été in fine les grands bénéficiaires des chocs pétroliers des années 1970 (p 241-242).
Ces quelques réserves émises, il reste que l’ouvrage de Vijay Prashad brille par son extraordinaire érudition et sa remarquable capacité de synthèse. Le développement, appuyé par de nombreuses et abondantes notes de bas de page, fournit non seulement une histoire globale du Tiers monde mais aussi des éclaircissements utiles sur l’histoire particulière de certains États le composant. La progression du livre, d’abord déroutante, contribue à restituer la diversité du Tiers monde: chaque chapitre porte le nom d’un lieu emblématique du Tiers monde, et à partir de ce point de départ traite à la fois d’un thème et d’un pays sur lequel un coup de projecteur se trouve donné. De cette manière, chaque chapitre aborde un aspect ou un problème nouveau du projet tiers-mondiste (« imaginer une économie », « cultiver un imaginaire », « Danger: Etat autoritaire ») tout en brossant le tableau d’un pays et de son histoire politique parfois connue (Cuba, Algérie, Inde), et parfois méconnue (Bolivie, Tanzanie, Jamaïque).
Dans une première partie intitulée « la quête », le livre relate la genèse d’un projet multiforme.
Si l’invention du concept de Tiers monde vise à différencier le pays décolonisés du monde occidental comme du monde communiste, ses racines sont antérieures au conflit est-ouest et à la seconde guerre mondiale. L’acte de naissance du Tiers monde scellé à la conférence de Bandung (1955) couronne un processus de rapprochement entre les mouvements indépendantistes entamé dès les années 1920. Le premier rassemblement d’ampleur a lieu à Bruxelles en 1928 lors de la Ligue contre l’impérialisme: les dirigeants de mouvement anticoloniaux ou anti-impérialistes, parmi lesquels figurent de futurs leaders du Tiers monde (Nkrumah, Sukarno), s’y livrent à une critique acerbe du colonialisme et jettent les bases d’une plateforme politique commune, ce que Vijay Prashad appelle un « nationalisme anticolonial » et « internationaliste » (par opposition au nationalisme agressif et impérialiste des Occidentaux). Ce rassemblement résulte lui-même de rapprochements régionaux, projets panaméricains, panafricains ou panasiatiques, qui ne seront d’ailleurs guère suivis d’effets. En dépit de ses maigres résultats dans les années qui suivent, cette Ligue contre l’impérialisme préfigure très nettement les orientations données au projet tiers-mondiste à la conférence de Bandung.
En 1955, alors que le processus de décolonisation est entamé mais non encore achevé, il s’agit pour les pays présents à Bandung de proclamer la fin du colonialisme « officiel » et de poursuivre l’élan en continuant la lutte contre l’impérialisme sous toutes ses formes. Vijay Prashad consacre plusieurs chapitres aux différentes façades du projet, dont certaines sont assez méconnues. Le résultat le plus visible et finalement le plus durable de Bandung, est l’intrusion d’un nouveau pôle sur la scène internationale: regroupement des pays décolonisés à l’ONU, création en son sein d’organisme ciblés sur les problèmes de développement (CNUCED), création du mouvement des non-alignés à la conférence de Belgrade en 1961.
Sur le plan économique émerge dès les années 1940 en Amérique latine puis dans l’ensemble du Tiers monde, une réflexion sur la notion de développement: comment ces pays peuvent-ils se développer sans en passer par une sujétion vis à vis des puissances économiques dominantes occidentales, que ce soient les États-Unis ou les anciens colonisateurs européens? Les économistes du développement comme l’argentin Paul Prebisch, critiquant la théorie des avantages comparatifs, ne voient de possibilité de développement qu’en dehors du capitalisme libéral, ou du moins dans un libéralisme très organisé: système de cartels pour garantir des prix corrects à l’exportation, protectionnisme tempéré et substitution aux importations pour protéger les industries naissante de la concurrence du monde occidental, planification et rôle directeur de l’État pour assurer l’investissement indispensable au démarrage d’une économie de type industriel. Faute de quoi, les pays du Tiers monde resteraient des exportateurs de matière première prisonniers des économies développées qui étoufferaient tout développement industriel de leur part. Par la création d’organismes au sein de l’ONU (CNUCED) ou en dehors d’elle (groupements régionaux), il s’agissait d’ « unifier le pouvoir économique et politique du Tiers monde, en vue d’élaborer de nouveaux types d’échange et d’ainsi réduire les effets néfastes de l’exploitation impérialiste » (p 96) dont étaient porteurs le système FMI-GATT du point de vue des théoriciens du développement. Mais au-delà des échanges, le problème était aussi d’avoir le capital nécessaire pour investir dans ces économies: les capitaux d’origine occidentale étant suspectés de véhiculer l’impérialisme néo-colonial, la seule solution était un transfert de ressources justifié par la dette économique et morale des anciens colonisateurs: « Si les nations obscures se trouvaient appauvries par le régime colonial, l’Europe et les Etats-Unis s’en étaient pour leur part approprié les richesses pour effectuer leur grand bond en avant. […] Puisqu’ils avaient profité du régime colonial, ils devaient en assumer les responsabilités: le premier monde se devait d’octroyer des subventions sans condition au Tiers monde (on parlerait par la suite de « réparations »). Il serait moralement reprochable de contraindre les peuples du Tiers monde à se sacrifier encore au nom du développement » (p 91-92).
En outre, pour un certain nombre de penseurs du Tiers monde, l’indépendance politique et économique nécessitait un substrat culturel: « cultiver un imaginaire ». Passant en revue les analyses de Césaire (et son fameux concept de négritude), Fanon, Neruda ou Senghor, Vijay Prashad consacre à cette question un des chapitre les plus intéressants du livre, mais aussi un des plus révélateurs des contradictions potentielles du Tiers monde. Pour se dégager de l’emprise culturelle occidentale, il convenait pour les nouveaux États de bâtir une identité nationale à partir des cultures antérieures au colonialisme en dépassant le clivage culture coloniale/culture « indigène », mais sans encourager un traditionalisme à bien des égards contraire au contenu politique et social du projet tiers-mondiste: « Les artisans de la culture fidèles à une vision dichotomique n’aidaient pas à la nécessaire critique des stéréotypes coloniaux, les endossant souvent non pour les vilipender, mais pour les célébrer. Les tribus, les paysans, symbolisaient la nation sans pour autant l’habiter. Ils en restaient à l’extérieur, soit confinés, soit convertis, sans en être considérés comme des citoyens à part entière. […] [Selon Césaire], c’est seulement dans la tourmente d’un grand mouvement social, à l’image d’une lutte anticoloniale, que les sociétés colonisées peuvent reprendre vie et s’ouvrir au changement. Les nouveaux États épousaient une vision multinationale, sachant très bien que leurs pays abritaient une réelle diversité culturelle. Il s’agissait d’une mesure pratique, ,puisque nombre d’entre eux naissaient de sociétés culturellement diversifiées et difficiles à unifier. […] Pour ses adeptes, le multinationalisme était une croyance idéaliste. Ils souhaitaient que les peuples se respectent mutuellement (diversité) et, puisque leurs mondes culturels se chevauchaient déjà, tolèrent leurs différences (culture composite). Mais la visée du projet national allait plus loin, gageant sur l’édification de marchés et d’institutions scolaires pour empêcher les différences de dominer la vie sociale. Une unité d’ensemble (une identité nationale) allait supplanter (mais non renverser) les autres identités sociales, l’identification au projet national s’avérant plus importante que l’adhésion aux identités héritées du passé. Aussi ce projet progressiste autrement valable renfermait-il un vice caché: celui d’être majoritariste » (p 115-117). Il s’agissait en somme de bâtir des identités nationales porteuses d’émancipation sociale (y compris pour les femmes, à qui le livre consacre un chapitre) sans qu’elles dégénèrent en nationalisme, problème toujours actuel dans un certain nombre d’États de l’ancien Tiers monde.
Mais s’il dépeint les différentes facettes du projet tiers-mondistes avec beaucoup (trop?) de cohérence, l’auteur ne cache pas que ce projet présentait des faiblesses dès le départ, essentiellement parce que l’unité du Tiers monde était largement artificielle. Pour des États dont le positionnement politique allait du communisme à l’alliance avec les États-Unis, le non alignement ne faisait pas l’unanimité. L’insertion économique du Tiers monde dans les échanges internationaux et la politique du développement voyaient s’affronter des politiques largement antagonistes. A Bandung, le seul domaine où se dégagea une réelle entente fut la coopération culturelle. Last but not least, non seulement les États du Tiers monde étaient initialement en désaccord sur la stratégie à suivre envers l’Occident, mais cette fracture ne fit que s’élargir par la suite. Alors que pour certains la constitution du Tiers monde devait assurer l’indépendance des nouveaux États en les tenant à l’écart du conflit est-ouest (Nehru, Nasser, Sukarno, U Nu), d’autres (Castro, Che Guevara, Nkrumah, Cabral) y voyaient au contraire le fer de lance de la guerre révolutionnaire à mener contre l’impérialisme occidental et rejetaient la coexistence pacifique. Dans le climat contestataire des années 1960 et de la guerre du Vietnam, ces derniers proposèrent à la conférence tricontinentale de la Havane (1966) de raviver la lutte armée non seulement en tant que lutte anticolonialiste mais en tant que stratégie en soi: « Des cortèges de militants et d’organisations de libération nationale affluèrent dans cette période aux rencontres du Tiers monde, réclamant une action armée contre l’impérialisme. Ils aimaient provoquer les délégués soviétiques, et balayaient toute considération sur les limites éventuelles du sentiment populaire anti-impérialiste dans les pays qu’il fallait libérer par les armes. Certains militants, reprenant la critique de la théorie des deux camps, soutenaient que la seule force à même d’opposer l’impérialisme des États-Unis comme de l’URSS était celle d’une libération nationale par les armes. On s’attelait à copier la méthode révolutionnaire cubaine ou chinoise sans chercher à saisir les raisons particulières de leur succès. […] Les militants rejetaient théorie et débats au profit d’une tactique insurrectionnelle visant à prendre et à maintenir le pouvoir par la lutte armée. Les considérations pour le combat des masses ou le rôle crucial du parti ne devaient pas freiner l’avancement de la guerre révolutionnaire. […] [A la conférence de la Havane] certains ayant un faible pour les forces progressistes souhaitaient suivre la voie de la coexistence pacifique et mettre en place les institutions onusiennes. D’autres prônaient d’entrée le militantisme, appelant à défier l’impérialisme sur le champ de bataille et par de petits actes révolutionnaires ou de terrorisme. Le Vietnam était au cœur des débats » (p 144-145). Cette fuite en avant du tiers-mondisme dans les années 1960 et 1970 était paradoxalement le prélude à son essoufflement, car le projet du Tiers monde s’est rapidement trouvé confronté à un certain nombre d’impasses.
La deuxième partie de l’ouvrage, « Ecueils », dresse le tableau des apories et des dérives du projet tiers-mondiste à l’épreuve de la réalité dans les années 1960 et 1970, que l’on peut imputer soit à la dénaturation du projet, soit aux mirages qu’il contenait.
Mirage de l’indépendance, tout d’abord. Ce que Vijay Prashad appelle un « nationalisme anticolonial », faisant l’unité du Tiers monde contre le monde occidental, s’est vite doublé de nationalismes plus classiques qui dressait certains États les uns contre les autres, en dépit de toutes leurs professions de foi internationalistes. La courte guerre de 1962 entre les deux poids lourds du Tiers monde, la Chine et l’Inde, a marqué une césure à cet égard: « Les Etats postcoloniaux, concernant les frontières, adoptèrent alors une conception bien plus « européenne » du nationalisme que celle qu’ils validaient auparavant en tant que forces anticoloniales. L’idée de nationalisme défendue par les mouvements anticoloniaux allait être remise en question par le processus même de formation des Etats: […] l’adhésion à une vision mystique du nationalisme, étrangère aux mouvements coloniaux » (p 216).
Sur le plan économique également, le système alternatif proposé par les économistes du développement pour assurer l’indépendance du Tiers monde vis à vis de ses anciens maitres s’avéra un trompe-l’oeil: les rares cartels qui purent voir le jour profitèrent essentiellement à une poignée de pays, même si la rhétorique tiers-mondiste demeurait. L’OPEP, créée en 1960, en fut l’exemple le plus emblématique, les intérêts des États pris séparément s’avérant beaucoup plus déterminants que l’intérêt général des pays en développement claironné dans les déclarations publiques : « Malgré ses origines politiques, l’OPEP était devenue un cartel commercial qui s’en tenait grosso modo à défendre les prix du pétrole. […] Bien que les membres radicaux de l’OPEP, comme la Libye au début des années 1970, aient appelé à imposer différents prix aux diverses nations du monde, la vision strictement économique de l’OPEP fit avorter tout arrangement politique de ce type. Dans l’ensemble, les cartels de matières premières n’aidaient pas forcément les pays du Tiers monde et ne lésaient pas forcément les pays industriels avancés » (p 240-243).
Surtout, à l’intérieur des Etats, le consensus politique national s’est effrité rapidement, chaque courant suspectant l’autre de vouloir récupérer à son seul profit les fruits du tiers-mondisme. Les adversaires des nationalistes les soupçonnaient de cacher sous la rhétorique de l’indépendance leur conservatisme social et politique; les adversaires des marxistes voyaient d’un mauvais œil leurs accointances avec les puissances communistes, et craignaient qu’ils soient finalement un ferment d’instabilité politique et sociale dans États encore en construction. En dépit de leurs contribution aux mouvements indépendantistes puis à la construction des nouveaux États, les mouvements communistes furent réprimés et éliminés dans de nombreux pays dans les années 1960, sous le regard indifférent et avec parfois l’accord tacite de l’URSS et de la Chine, qui cherchaient à renforcer leur influence dans le Tiers monde, fût-ce en sacrifiant les mouvements communistes autochtones. Outre le bilan humain de ces répressions (pour l’élimination du PKI indonésien en 1965-66, les estimations varient de 100 000 à 2 millions de morts), l’affaiblissement des forces de gauche dans un certain nombre de pays a marqué pour Prashad un premier reniement du Tiers monde: « L’anéantissement de la gauche eut un impact énorme sur le Tiers monde. Les classes sociales les plus conservatrices, voire réactionnaires, l’emportèrent sur la plate-forme élaborée à Bandung. Subordonnées aux régimes militaires, les forces politiques émergentes rejetaient le nationalisme œcuménique et anticolonial des sympathisants de gauche et des libéraux au profit d’un sauvage nationalisme culturel qui valorisait le racialisme, la religion et la hiérarchie. Elles se protégeaient derrière une vision fabriquée de la « tradition » – prétendant être les véritables porte-paroles de leur culture d’origine, par opposition aux forces progressistes de gauche qui exerçaient une influence « moderne » et « occidentale ». Toutes ces interprétations de la tradition qu’étaient les mythes du paradis balinais, du puritanisme arabe, du hiérarchisme hindou ou encore du tribalisme africain naissaient de la vengeance des anciennes classes sociales qui combattaient la gauche et, une fois celle-ci écartée, se proclamaient l’unique représentant de leur civilisation » (p 211).
Le mirage de l’indépendance renvoyait donc au mirage de l’État: un État que les théoriciens de l’utopie tiers-mondiste avaient voulu juste, démocratique, et capable d’une transformation prométhéenne des sociétés du Tiers monde. C’était compter sans le fait qu’un État fort pouvait également être l’instrument d’un régime dictatorial et conservateur. Dans les faits, la démocratie promise s’est avérée dans de nombreux pays du Tiers monde soit absente, soit éphémère, et ce dès l’époque de Bandung, comme le montre le cas de l’Egypte nassérienne. De l’émergence d’États forts dans le Tiers monde résultaient deux dérives possibles et liées: la « bureaucratisation » (que l’auteur explore longuement à travers le cas algérien) et le poids excessif de l’armée (en termes économique et politique) conduisant à des dictatures militaires. Par-delà la diversité des situations (dérive dictatoriale algérienne avec l’éviction de Ben Bella, putschs militaires sud-américains, rôle politique de l’armée dans les États d’Asie du sud-est, régimes arabes autoritaires, guerres civiles africaines…), Vijay Prashad dresse un scénario archétypal de cette dérive. L’État, initialement garant de l’indépendance et/ou hérité des mouvements indépendantistes, tend à se considérer comme seul apte à assurer la transformation politique et sociale des sociétés décolonisées, repoussant toujours pour plus tard la démocratie sociale promise (« La liste des réforme importe moins que la nature de la gouvernance: l’État allait-il déléguer le pouvoir au peuple, l’intégrer à son action, ou bien allait-il démobiliser le mouvement de libération nationale et créer le changement par la voie bureaucratique? Dans ce cas, l’État dictait ses ordres au peuple qui, pourtant, rêvait pendant la lutte de participer à la construction nationale. […] Le projet de libération nationale adhérait volontiers à une vision naturaliste des droits politiques: si l’on supprime le pouvoir colonial, si l’on confie l’État aux forces de libération nationales, si ces forces mettent en place un modèle économique convenable, alors le peuple sera libre », p 167-168). En se coupant de la population, il est de plus en plus instrumentalisé par les forces sociales « conservatrices » de la société, qui cherchent à maintenir l’ordre social en l’état. L’armée, dont le poids économique et politique croit à mesure que les antagonismes entre États du Tiers monde deviennent plus évident derrière la rhétorique tiers-mondiste, est instrumentalisée dans le même sens et peut alors soit prendre le pouvoir (putsch militaire), soit éliminer à la demande des gouvernants les forces politiques contestataires. Le régime autoritaire ainsi établi promeut derrière la rhétorique unitaire un nationalisme agressif qui justifie les dépenses engagées dans le domaine militaire (plutôt que dans le domaine social), dépenses militaires qui ne font que renforcer le poids de l’armée comme soutien du régime, bouclant le cercle vicieux de l’autoritarisme.
L’auteur n’en oublie cependant pas l’autoritarisme dans sa version de gauche, le socialisme constituant lui aussi un des mirages du Tiers monde. Approfondissant l’exemple de la Tanzanie de Julius Nyerere, il montre comment le projet tiers-mondiste a aussi échoué faute de remplir sa propre exigence de démocratie : « Pressé d’agir par le pays industriels avancés, par l’aristocratie rurale et par les classes commerçantes en émergence, le nouvel Etat devait faire vite. Il fallait que ça change. Mais le socialisme requiert de l’imagination et du temps, il ne peut sa bâtir à la va-vite. Fondant ainsi le socialisme à la hâte, sans l’appui des masses et sans institutions aptes à canaliser cet appui, de nombreux Etats du Tiers monde allaient courir au désastre. […] L’État parlait du peuple tout en s’en dissociant. Il omit d’identifier des partenaires privilégiés dans les classes de la paysannerie, et omit de fonder des institutions permettant à ces acteurs de promouvoir le changement social. Sans même avoir de plan précis pour donner force à ses idées, l’État se postait au-dessus du peuple, lui disait quoi faire, prêchait le ’socialisme par en haut’ » (p 244-248). Dans son programme d’Arusha de 1967, Nyrere postulait que la modernisation agricole devait servir de socle au développement industriel, et donc que la construction du socialisme se jouerait dans les campagnes, où il fallait briser au préalable les instruments de domination traditionnelle et imposer l’État comme matrice du changement. Pour cela, son gouvernement élabora la notion de « village socialiste », sorte de mixte entre une vision mythique de l’agriculture traditionnelle et le modèle agricole soviétique. Faute de structures adéquates et d’explications suffisantes, c’est de manière autoritaire que ce remodelage rural fut effectué, aboutissant au déplacement forcé de trois millions de personnes, soit 20% de la population du pays. L’expérience tanzanienne fut à la fois un échec (car peu efficace) et un désastre (car elle désorganisa le pays), emblématique du « socialisme précipité du Tiers monde qui devenait alors non démocratique et autoritaire »: « La plupart des Etats se sont empressés de construire des usines et des barrages, de déboiser des forêts, de déplacer des populations. Ce travail répondait à plusieurs besoins, avant tout celui d’accroitre au plus vite la capacité de production des nouvelles nations, de faire un grand bond en avant pendant que la prospérité était là et avant que ne s’épuise le capital politique des mouvements de libération. Si les intentions des dirigeants n’étaient certainement pas malveillantes, ce rêve moderniste – régir la nature et la société, ériger une infrastructure industrielle sans pour autant créer de structure démocratique de gouvernance ou mettre à profit une population mobilisée – allait conduire aux pires excès de directivisme et de bureaucratisme » (p 251).
Néanmoins, par un curieux déni de sa propre démonstration, Vijay Prashad conclue que « le capital politique du Tiers monde subsistait, et le projet aurait pu surmonter ses propres écueils s’il n’avait dû faire face à un nouvel assaut frontal dans les années 1970 » (p 260). La dernière partie, « Assassinats », ne se départie jamais de cette ambiguïté: elle dresse un réquisitoire sans concession envers les « assassins » du projet tiers-mondiste (pays occidentaux et capitalisme libéral d’un côté, et leurs soutiens dans le Tiers monde de l’autre), mais à la lumière de la partie précédente, on a plutôt l’impression du crépuscule d’un projet moribond, auquel le renouveau libéral des années 1980 n’aurait fait que porter le coup de grâce.
C’est que le projet tiers-mondiste connait d’abord un renouveau trompeur dans les années 1970: les pays de l’OPEP exercent une forte pression sur les pays occidentaux, qui acceptent de négocier un nouvel ordre économique mondial (NOEI, revendication du Tiers monde jusqu’ici restée lettre morte), le système monétaire de Bretton Woods implose, le GATT semble s’essouffler, et le communisme connait une série de succès dans le Tiers monde au milieu des années 1970. Bref, les Occidentaux semblent devoir lâcher du lest face aux revendications des anciens pays décolonisés, englués dans une crise économique qui menace de se transformer en crise idéologique. Mais le Tiers monde ne saura rien faire de cette position de force en raison de ses propres faiblesses.
D’abord, le Tiers monde reste divisé. Au courant marxiste des non alignés, pour qui le problème principal est le capitalisme inégalitaire, s’oppose un courant libéral qui prône la croissance par l’insertion dans ce système économique et commercial mondial. Prashad consacre un chapitre à Singapour (« La tentation asiatique », p 307-324), fer de lance de ce dernier courant et vitrine d’un nouveau modèle de développement économique pour le Tiers monde, porté pour l’auteur par les nouvelles bourgeoisies nationale au détriment du projet tiers-mondiste: « Les figures intellectuelles qui appartenaient à cette classe fréquentaient les institutions internationales (comme le FMI et la Banque mondiale), observant là le passage du modèle keynésien de développement (l’État stimule la demande au moyen des programmes de sécurité sociale et des politiques salariales) au modèle d’accumulation monétariste (retrait de l’État, dont le rôle se borne à gérer la masse monétaire et à maintenir bas le taux d’inflation). [...] Cet apport de compétences et cet esprit d’entreprise enchantaient la bourgeoisie émergente des nations obscures, qui voyait l’avenir dans leurs yeux et non par la lorgnette du projet du Tiers monde. Peu intéressée à servir de mandataire commercial aux puissances atlantiques, cette classe avait foi en ses capacités et souhaitait se donner les moyens de réussir » (p 268). Prashad identifie la réunion des non alignés en 1983 (« New Dehli: la notice nécrologique du Tiers monde », p 263-280) comme le moment où le rapport de force s’est renversé en faveur du courant libéral au sein du tiers monde. Au-delà de la divergence idéologique, c’est aussi des fissures économiques de plus en plus grandes qui divisent le tiers monde: les pays de l’OPEP profitent des hausses pétrolières pénalisant la plupart des autres pays, et le décollage économique de ceux qu’on appellera par la suite les émergents accroit considérablement les écarts au sein du Tiers monde.
D’autre part, la crise économique des années 1970 révèle le talon d’Achille du modèle de développement adopté : l’endettement. Alors que les cours et les débouchés de leurs exportations chutent ou stagnent (exception faite du pétrole), les États du Tiers monde doivent supporter le fardeau de plus en plus lourd de la dette, cercle vicieux qui amène finalement la plupart à conclure avec le FMI de léonins « Plans d’ajustement structurels », avec ses corollaires biens connus: coupes dans les dépenses de l’État, dérégulation, ouverture commerciale, que Prashad étudie dans un chapitre détaillé sur le cas de la Jamaïque (« Kingston: la globalisation pilotée par le FMI », p 281-306). « La crise de la dette, conclue-t-il, c’était le cheval de Troie dans l’assaut mené sur le projet de construction d’une souveraineté sur le Tiers monde, désormais ajourné » (p 291).
Dans les années 1980, la globalisation libérale est incontestablement la fossoyeuse du projet tiers-mondiste, mais encore faut-il savoir ce qu’englobe le terme: dans son récit, Vijay Prashad amalgame allègrement les États-Unis, leurs alliés occidentaux, le G7, le FMI, les multinationales, les « élites » et « bourgeoisies nationales » du Tiers monde comme autant de pièces d’une stratégie concertée, si bien qu’on finit par ne plus savoir de quoi il est précisément question quand il parle des « forces abstraites » qui dominent le monde économique (p 306) et imposent des choix au Tiers monde. L’étude montre pourtant dans le détail quelque chose de moins manichéen: l’abandon du projet tiers-mondiste au profit d’un modèle libéral (dont la légitimité croît avec la fin de la guerre froide) ne relève pas seulement d’une contrainte exercée depuis l’extérieur mais d’une transformation d’ensemble du Tiers monde et d’un choix opéré dans un certain nombre d’États.
Dans son dernier chapitre (« La Mecque: quand la culture se fait cruelle », p 325-342), l’auteur explique d’ailleurs que l’affaiblissement du projet du Tiers monde est passé par des courants traditionnels et conservateurs du Tiers monde, au moins autant que par le modèle libéral importé d’Occident: « La globalisation pilotée par le FMI mit à terre les piliers de l’État souverain. Tandis qu’elle s’opposait au nationalisme, certaines forces sociales conservatrices et d’autres classes sociales tout aussi puissantes décidaient de s’unir pour présenter une définition autre du patriotisme, du nationalisme en vérité. Le nationalisme laïque et socialiste du tiers monde s’atrophiait devant l’essor d’un nationalisme culturel, la religion et autres particularités ataviques du même type » (p 341). A partir de l’exemple de l’islam wahhabite (et de ses vecteurs, la Ligue islamique mondiale puis l’Organisation de la conférence islamique), il montre comment l’enterrement du projet tiers-mondiste correspond à une exacerbation des replis nationalistes dans les anciens pays décolonisés à partir des années 1970. Menant à un éclatement du Tiers monde, elle explique pour l’auteur l’absence de projet politique héritier du tiers-mondisme, même s’il l’appelle de ses vœux en épilogue.
Au-delà de la définition étroite – et donc discutable – proposée du Tiers monde dans cet ouvrage, on ferme le livre en ressassant une question omniprésente mais jamais explicitement posée : les choses auraient-elles pu se passer différemment, et le Tiers monde aurait-il pu rester uni ? Si on considère l’histoire du Tiers monde comme l’histoire d’une utopie, on peut considérer, sur le ton fataliste de l’auteur, que son exigence était trop haute face à la persistance des résistances internes et externes. Si on la considère maintenant comme l’histoire d’un mouvement politique, il faut admettre qu’il était d’emblée pluriel, divisé et pétri de contradictions, et correspondant à un moment historique éphémère. Ce qui est mort, comme le montre l’épilogue de l’ouvrage sur les deux dernières décennies, ce ne sont pas les idées portées par le projet tiers-mondiste, mais l’idée que les anciens colonisés puissent s’organiser en un ensemble organique et cohérent apte à façonner un nouveau système mondial. Mais le lien essentiel entre ces pays étant l’héritage colonial, n’était-il pas inévitable que ce lien se distende ?
Cet ouvrage, malgré les réponses qu’il apporte, laisse donc ouvertes un certain nombre de questions, et s’impose de ce fait comme une lecture stimulante, autant par ses parti-pris que par la mine d’informations qu’il constitue.
Noël Bonhomme est agrégé d’histoire et allocataire-moniteur à l’université Paris IV. Ses recherches portent sur la politique extérieure de la France dans la seconde moitié du XXe siècle.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F6%2F7%2F671849.jpg)








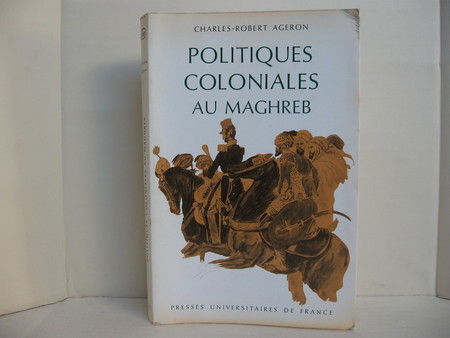
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F28%2F66%2F779121%2F56853572_o.jpg)